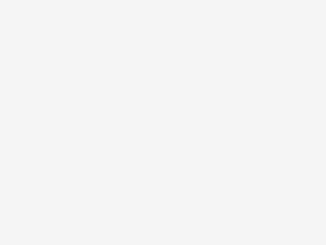(Exposé donné au groupe de travail « Psychanalyse et sciences sociales » à Saarbrücken le 22 mars 2025)
Qu’est-ce que la science ?
La science n’est pas une « chose » que l’on pourrait définir comme une chaise, une table ou un arbre. La science est une activité, un processus qui doit servir, dans le sens le plus général, à la fabrication ou à la production de connaissances correctes ou visionnées.
Ici, tous les aspects sont alors importants :
- Qui est l’acteur, ou qui sont les acteurs de ce processus ?
- L’acteur ou le producteur est-il un individu ou un groupe, une collectivité ?
- Et qui est l’individu ou le groupe qui peut légitimement faire de la science ?
- Comment se déroule ce processus ? N’y a‑t-il qu’une seule façon de produire des connaissances correctes ou avérées ? Y en a‑t-il plusieurs ? Quelles sont alors les vraies et les fausses, les bonnes ou les mauvaises, et comment distinguer les unes des autres ?
- Qu’entend-on exactement par savoir « vrai » ou savoir « avéré » ? Qu’est-ce qui rend la connaissance « vraie » vraie ou la connaissance « sûre » sûre ?
- De quel type de savoir s’agit-il ? Le savoir scientifique est-il un savoir sur les dieux, un savoir sur les concepts, un savoir sur les vérités, un savoir sur les livres, un savoir sur la nature, sur les gens, etc.
- Avec ces questions, on se heurte immédiatement à trois types de complications qu’il est difficile d’éviter si l’on ne veut pas définir l’activité que l’on appelle science simplement à partir du vide.
1. Les complications historiques
La réponse la plus générale à ces questions est la suivante : l’histoire de la science a fourni une multitude de réponses différentes à ces questions. Et, il est possible, à partir des réponses, de distinguer une science antique d’une science médiévale, d’une science de la Renaissance. On peut aussi distinguer la « révolution scientifique » des 16ᵉ et 17ᵉ siècles de la science industrielle moderne des 18ᵉ et 19ᵉ siècles en fonction des réponses à ces questions. De la même manière, cette dernière peut être distinguée de la science contemporaine.
Ce sont donc les grandes époques historiques de la science, dans lesquelles la science est pratiquée par des acteurs différents, avec des objectifs historiquement différents, et avec des méthodes très différentes. La méthode platonicienne d’acquisition des connaissances a peu de points communs avec la méthode scolastique de la fin du Moyen Âge, tant au niveau de l’objectif que du contenu. Celle-ci est également remplacée par la première révolution dite scientifique, tant dans ses méthodes que dans ses intentions. La même chose peut être dite de la science industrielle moderne qui, aux 18ᵉ et 19ᵉ siècles, comprend la science, déjà très contemporaine, comme une rationalité de finalité, c’est-à-dire une activité qui ne vise pas tant la connaissance ou le savoir en soi que le savoir techniquement disponible. Cette science, Herbert Marcuse et Jürgen Habermas le pensaient déjà à la fin des années 60, est liée dans son essence – et même jusque dans les détails de ses méthodes scientifiques – au mode de production capitaliste.
Je cite Habermas :
Avec la recherche industrielle à grande échelle, la science, la technique et l’exploitation ont été réunies en un seul système. Elle s’associe désormais à la recherche sous contrat de l’État, qui promeut principalement le progrès scientifique et technique dans le domaine militaire. De là, les informations reviennent dans les domaines de la production de biens civils. La technique et la science deviennent ainsi la première force productive, ce qui supprime les conditions d’application de la théorie de la valeur travail de Marx. (Habermas, 2014, p. 79 – 80).
Cette brève description montre à quel point la science s’est transformée au 19ᵉ siècle en une science technique générale, dont les tâches sont abandonnées par l’État et servent d’abord les intérêts militaires. L’OTAN parle encore aujourd’hui de « technologie à double usage », c’est-à-dire une recherche militaire qui peut également trouver des applications civiles.
On peut facilement citer des exemples issus de la recherche militaire : les réacteurs nucléaires, le GPS, Internet, les images satellites, les matériaux complexes (fibre de carbone, titane), les lasers, les drones, la cryptographie et la cybersécurité, la robotique et, dans une large mesure, l’intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd’hui. Ici, on peut bien sûr aussi énumérer les progrès médicaux qui proviennent directement de la recherche militaire : Le traitement des traumatismes et la médecine d’urgence ou les vaccins et la recherche sur les infections, par exemple dans le cadre de la recherche sur des maladies comme le typhus, la grippe et la fièvre jaune pendant la Première Guerre mondiale, la vaccination contre la grippe, la fièvre jaune et la dengue pendant la Seconde Guerre mondiale, la surveillance épidémiologique et la réponse aux épidémies. Je reviendrai une autre fois sur les influences de la recherche militaire sur la psychothérapie – ainsi que sur la thérapie cognitivo-comportementale.
Il serait faux de penser que la science n’a pas évolué de la même manière depuis la Seconde Guerre mondiale au moins. Bien au contraire, les développements se sont accélérés en raison de la pression croissante de l’innovation et de la privatisation progressive de la science.
Ainsi, la courte période qui suit la Seconde Guerre mondiale peut encore une fois être divisée en plusieurs périodes : la période de la soi-disant « Big Science » à la fin de la guerre, avec ses grands projets financés par l’État et l’institutionnalisation intégrale de la recherche, la science de la guerre froide avec sa spécialisation croissante, la science de la révolution numérique et de l’ère de l’information à partir de 1980, qui va de pair avec la néolibéralisation de la science. À partir des années 2000, il y a de nouveau un changement dans les méthodologies scientifiques, ainsi que dans les objectifs de la science, qui vont de plus en plus vers le rendement du capital. Mais, l’aspect du contrôle social, qui avait bien sûr déjà commencé avec la science industrielle du 19ᵉ siècle, devient également une branche essentielle de l’économie et de la recherche (voir Zuboff, 2019).
2. Complications épistémologiques
Si la recherche militaire sur les bombes atomiques n’a pas grand-chose en commun avec le capitalisme de surveillance, et si la science industrielle est aussi différente de la lecture du livre de la nature de Galilée que de la connaissance scolastique de Dieu ou de l’anamnèse platonicienne du vrai, du bien et du beau, alors on se heurte à la question de savoir où situer, sinon définir, « la » science.
Quelle est la science scientifique ? Ou, autrement dit : quelle est la vraie science, et qu’est-ce qui relève au contraire de l’erreur, de l’illusion ou de la pseudoscience ? La réponse habituelle, celle qui domine encore aujourd’hui dans l’enseignement universitaire, est souvent de nature présentiste. Elle revient à postuler que la science actuelle est la bonne, et que tout ce qui précède n’était qu’approximations, errements, ou formes déficientes de ce que nous savons aujourd’hui. Autrement dit, la science, ce serait ce que nous faisons maintenant, dans les laboratoires, avec la méthode scientifique, les protocoles, la quantification, la réplication, la revue par les pairs.
Mais ce type de réponse, fondée sur une lecture téléologique et anachronique de l’histoire des savoirs, masque les discontinuités profondes qui traversent les pratiques dites scientifiques. Comme l’a montré Michel Foucault, il n’y a pas de science définissable en soi, mais des configurations de savoirs et de pouvoirs, des « épistémès » historiques, qui structurent ce qu’il est possible de dire, de penser, d’expérimenter à un moment donné (Foucault, 1969/2008).
Il n’y a pas de continuité pure entre les catégories intellectuelles de l’astronomie grecque, de la physique galiléenne, de la biologie lamarckienne, de la cybernétique ou de la data science. Croire que l’on peut définir « la » science par quelques critères universels et intemporels (objectivité, falsifiabilité, rationalité, reproductibilité, etc.) relève d’une illusion rétrospective, déjà critiquée par Paul Feyerabend, qui insistait sur la pluralité des méthodes et des approches scientifiques à travers l’histoire (Feyerabend, 1975/1988).
Le critère de démarcation entre science et non-science, que Karl Popper avait tenté de formuler en termes de falsifiabilité, est lui-même inopérant dès lors que l’on regarde les pratiques réelles de la recherche. Nombre de théories dites scientifiques ne sont ni falsifiables au sens strict, ni reproductibles, ni indépendantes des conditions socio-institutionnelles de leur production (Popper, 1934/2009).
Les finalités de la science varient, elles aussi, à travers les époques : contemplatives chez Galilée, théologiques chez Thomas d’Aquin, techniques chez Bacon, militaires dans le projet Manhattan, commerciales dans le capitalisme algorithmique. La science ne vise pas toujours à connaître, mais parfois à produire, à anticiper, à gouverner, à exploiter. En ce sens, ce que nous appelons science est aussi un dispositif de pouvoir, comme l’ont montré Bruno Latour et Steve Woolgar dans leur étude pionnière sur la vie de laboratoire (Latour & Woolgar, 1979/1988).
L’histoire des sciences ne peut donc pas être racontée comme celle d’une progression linéaire vers la vérité. Elle est faite de ruptures paradigmatiques (Kuhn, 1962/1983), de luttes de reconnaissance symbolique, d’intrications entre intérêt cognitif, stratégique, politique, moral. Elle est aussi faite d’oubli : ce que l’on nomme aujourd’hui pseudoscience fut parfois, hier, le sommet du savoir. La mémoire collective des sciences est sélective, normalisée, filtrée par des institutions académiques et des conventions éditoriales.
Définir ce qu’est la science suppose donc une double critique : critique du présentisme (Koselleck, 2004), qui juge le passé selon les normes du présent, et critique de l’essentialisme, qui prête une identité fixe à des pratiques historiquement situées. Une véritable compréhension de la science requiert une approche généalogique, attentives aux contextes, aux déplacements, aux conflits et aux hétérogénéités.
3. Complications normatives
Depuis le « cercle de Vienne », c’est-à-dire le néopositivisme ou l›« empirisme logique » à la fin du 19ᵉ siècle, la question de la scientificité de la science, la question épistémologique est aussi presque indissolublement liée à la question normative : Il y a une science juste et une science fausse, et la science fausse n’est pas seulement inutile – elle ne peut servir à aucune production technique – mais elle est souvent l’œuvre d’intentions peu glorieuses.
La question qui est le plus souvent associée à la philosophie de la science de Popper – le problème de la délimitation – ne doit donc jamais être comprise uniquement comme une question épistémologique. La question de la bonne science est aussi une question normative, c’est-à-dire une question morale.
Mais cela entraîne une série de nouveaux problèmes. Je rappelle les deux querelles de jugement de valeur en Allemagne.
Le premier, qui, avant même la Première Guerre mondiale, opposait Max Weber, Werner Sombart à des socialistes comme Gustav von Schmoller et Lujo von Brentano.
La thèse de Max Weber sur l’absence de valeur stipulait – dans sa version normative – que la science devait séparer les déclarations de faits des jugements de valeur. Le scientifique devrait donc être aussi conscient que possible de ses propres jugements de valeur afin de les séparer de son travail scientifique. C’est ainsi que l’on parlait aussi en psychanalyse après 1945 de la « neutralité bienveillante », qui n’apparaît pas dans l’œuvre de Freud, mais qui devait décrire la « règle d’abstinence »[1]. On retrouve même cette idée dans la dernière publication de Bourdieu sur la science de la science et la réflexivité.
La critique de la norme de liberté des valeurs a été contestée dans la mesure où, par exemple, par Schmoller, les questions de recherche, mais aussi la méthodologie, l’interprétation des données et finalement l’orientation politique de la recherche sont toujours teintées de normativité.
La deuxième querelle sur les jugements de valeur était la querelle du positivisme qui, dans les années 1960, opposait les représentants de la théorie critique comme Adorno, Habermas et Horkheimer à Popper et Hans Albert. Cette querelle est devenue plus connue sous le nom de « querelle du positivisme ». Ici, la situation problématique se présente un peu différemment. Les deux parties supposent qu’il ne peut pas y avoir de neutralité des valeurs dans les sciences sociales, mais la question est de savoir si les sciences sociales doivent se limiter à des aspects particuliers de la société, et donc soutenir l’ingénierie sociale par morceaux vers des réformes sociales, ou si le regard doit se porter sur la totalité du système social capitaliste afin de le critiquer.
La discussion sur l’absence de valeur concerne cependant aussi les sciences naturelles, à commencer par la sociologie de la science de Robert K. Merton au début des années 1970. Bien que Merton ait exigé les soi-disant normes CUDOS pour la science – Communalism, Universalism, Disinterestedness, Organized Skepticism – il les considérait également comme des idéalisations impossibles à atteindre. Avant Bourdieu, Merton a précisé que les scientifiques travaillent dans un champ social caractérisé par des structures de pouvoir à l’intérieur et dépendant de facteurs politiques et financiers à l’extérieur, ce qui rend impossible une neutralité totale. Ceux-ci conduisent alors à des phénomènes de perception et de confirmation sélectives, tant au niveau du contenu que de la méthodologie, qui sont moins sceptiques que favorables aux approches théoriques et aux résultats dominants.
Dans les sciences naturelles aussi, il y a donc une normativité, même si elle est mieux masquée, aussi bien dans le choix des questions de recherche que dans le financement public et privé et ses influences institutionnelles, que dans les décisions méthodologiques, les interprétations des résultats de la recherche, les stratégies de publication et de communication médiatique. La science moderne est et a été depuis le début également un instrument de pouvoir politique.
Cela permet alors de réfléchir à la neutralité des valeurs et à l’objectivité scientifique : être instrumentalisé dans le discours politique ou dans le marketing économique lui-même, pour masquer la sélectivité des approches de recherche, l’interprétation des résultats, les intérêts politiques et économiques. La liberté de jugement de valeur instrumentalisée devient ainsi une autorité politique ou financière que l’on peut considérer comme non scientifique en la contredisant.
Bibliographie
- Feyerabend, P. (1988). Contre la méthode (J. Freund, Trad.). Paris : Seuil. (Ouvrage original publié en 1975)
- Foucault, M. (2008). L’archéologie du savoir. Paris : Gallimard. (Ouvrage original publié en 1969)
- Habermas, Jürgen. 2014. Technik und Wissenschaft als « Ideologie ». Francfort : Suhrkamp. (Ouvrage original publié en 1969)
- Koselleck, R. (2004). Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques (J. Hoock & M. Wiewiorka, Trad.). Paris : Éditions de l’EHESS.
- Kuhn, T. S. (1983). La structure des révolutions scientifiques (L. Meyer, Trad.). Paris : Flammarion. (Ouvrage original publié en 1962)
- Latour, B., & Woolgar, S. (1988). La vie de laboratoire : La production des faits scientifiques (D. Pestre, Trad.). Paris : La Découverte. (Ouvrage original publié en 1979)
- Popper, K. (2009). La logique de la découverte scientifique (M. Bouvier, Trad.). Paris : Payot. (Ouvrage original publié en 1934)
- Zuboff, Shoshana. 2019. The Age of Surveillance Capitalism. Main. Londres : Profile Books.
Notes
1 Freud lui-même avait un point de vue plus nuancé à ce sujet : « Les règles techniques que je propose ici m’ont été suggérées par ma propre expérience de longue date […]. J’espère que leur prise en compte épargnera aux médecins analystes beaucoup d’efforts inutiles et les protégera de bien des oublis ; mais je dois dire expressément que cette technique s’est avérée être la seule appropriée à mon individualité ; je n’ose pas nier qu’une personnalité médicale tout à fait différente peut être poussée à préférer une autre attitude envers le malade et envers la tâche à résoudre ». (Freud. 1912. « Conseils pour le médecin dans le traitement psychanalytique ». GW, vol. VIII, p. 376)