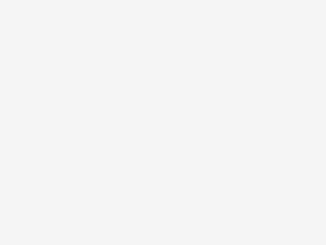In short, liberalism plays while power deals ; it is concerned mostly with legitimating itself while its norms and forms of power corrupt even its own mildest promises of fairness, privacy, political equality, participation. (Brown, 2007)
Résumé : En 2008, Sheldon Wolin proposait une réflexion sur les changements politiques que les États-Unis ont connus après les attentats de septembre 2001 à New-York. Wolin décrit le mélange de politique sécuritaire et d’économisation d’un État aux ambitions impériales comme « totalitarisme inversé ». Alors que le diagnostic de Wolin ressemble aux analyses de la post-démocratie par Colin Crouch, elles s’étayent sur une notion radicale du politique qui situe le politique dans les moments fugitifs d’une révolution de la vie collective.
Après les attentats du 11 septembre, les États-Unis entreprirent, sous la présidence de G.W. Bush, de changer profondément le système politique américain. Sur le plan politique et institutionnel, ce changement mettait en œuvre une extension importante du pouvoir exécutif aux dépens de la séparation des pouvoirs et aux dépens de la population. Ces changements entrainèrent un profond remaniement de la doctrine des « checks and balances ».
Avec le Patriot Act de 2001, le gouvernement Bush s’accordait, entre autres, des droits de surveillance électronique inouïs, autant de la population nationale, que de toute personne d’intérêt à l’étranger. Ces mesures avaient comme conséquence, ou peut-être même comme but la restriction des droits à la défense, au respect de la vie privée et à la liberté d’expression.
Loin de se limiter aux seuls États-Unis, la surveillance et l’intervention peu ou pas règlementées étaient conçues pour être internationales, et donc détachées de tout droit international en matière de collection de données ou d’interventions.
Si le Patriot Act constitue le versant le plus connu de la « guerre contre le terrorisme », il ne représenta pourtant pas la seule tentative d’empiéter sur les droits et libertés fondamentaux. Dès 2005, il fut secondé par le programme Total Information Awareness, puis suivi par le Patriot Act II qui prévoyait déjà de constituer « une banque de données génétiques d’individus suspects, lesquels pouvaient être absolument n’importe qui puisque l’administration pouvait y faire figurer des personnes soupçonnées d’« association » avec d’autres personnes elles-mêmes « soupçonnées » de terrorisme. » (Sidel, 2006, 27)
De même, l’État américain s’accordait le droit de détenir toute personne sur simple soupçon de terrorisme. Le concept du terrorisme ayant été élargi pour impliquer la possibilité de tout « actes violents ou dangereux pour la vie humaine ». (ibid.)
Bien que remis en question pour leur caractère anticonstitutionnel, et pour leur « mise à rude épreuve » des droits de l’homme et du droit international (Jones & Howard-Hassmann, 2006, 68), ces mesures n’ont cessé d’être reconduites jusqu’en 2020.
Et les pays européens n’ont pas hésité à s’accaparer ce modèle politique politique de la « guerre contre le terrorisme » grâce à la notion et surtout la pratique de l’« état d’urgence » (Voir Hennette Vauchez, 2022). Le terrorisme n’était, bien évidemment, qu’une option parmi d’autres pour instrumentaliser les états d’exception.
Avec sa logique de la lutte contre un ennemi extérieur et surtout intérieur, les diverses « luttes » ou « guerres » d’auto-défense de l’État finissent ainsi par mettre en place des règlements de prévention sécuritaires et répressifs à la limite de l’arbitraire.
Pour prendre l’exemple français : du 14 novembre 2015 au 1ᵉʳ novembre 2017, « plus de 10 000 mesures administratives ont été prises, parmi lesquelles 4 444 perquisitions administratives, 754 arrêtés d’assignation à résidence, 656 interdictions de séjour, 59 zones de protection et de sécurité (ZPS), 39 interdictions de manifester, 29 fermetures de salles ou débits de boisson, 6 remises d’arme et 5 229 arrêtés autorisant des contrôles d’identité, fouilles de bagages et de véhicules » (Vauchez et al. 2018).
Retour aux États-Unis : huit ans après la mise en place du Patriot Act, en 2008, le politiste américain Sheldon Wolin proposait une lecture politique des conséquences de la « guerre contre le terrorisme ». Si son interprétation visait en premier lieu les États-Unis de G. W. Bush, nous pouvons reconnaître sans hésitation qu’elle a fini par s’appliquer tout aussi bien à l’Europe.
Le concept central de l’analyse de Wolin est celui du « totalitarisme » inversé. Il va sans dire que la notion de totalitarisme risque d’être aussi polysémique, aussi contestée et sémantiquement aussi usée que celle de la démocratie. Tenons-nous en, pour éviter l’interminable discussion sur les caractéristiques principales du totalitarisme ou de la démocratie, aux définitions qu’en fournit Wolin lui-même.
La démocratie
Partons d’une notion assez simple et schématique chez Wolin, qui pourra servir de contraste aux changements qu’il s’agira de concevoir. Une version simplifiée de l’idée de la représentation politique fera l’affaire, tout en sachant que Wolin a développé une notion bien plus réfléchie et complexe de la démocratie.
La conception traditionnelle de la démocratie est qu’il s’agit d’un système par lequel les citoyens délèguent le pouvoir au gouvernement, ce dernier ne disposant donc que des pouvoirs qui lui sont délégués. (Ibid., 43)
L’on pourrait compléter le tableau proposé par les 4 principes idéaltypiques du gouvernement représentatif de Bernard Manin : les dirigeants démocratiques sont élus à intervalles réguliers, malgré cette élection, ils préservent une certaine indépendance décisionnelle des électeurs, alors que les gouvernés ont le droit de s’exprimer librement, notamment en matière de choix et de décisions politiques et les décisions gouvernementales sont soumises à des débats publics. (Voir Manin, 2012, 17 – 18)
Le principe de la représentation suppose donc une population qui, d’une part, comprenne les décisions politiques, qui soit informée de ces décisions et de leurs raisons et qui, idéalement, intervienne activement dans le débat public. C’est aussi ce que Wolin en retient :
Dans un système véritablement démocratique, par opposition à un système pseudo-démocratique dans lequel on demande à un « échantillon représentatif » de la population s’il « approuve » ou « désapprouve », les citoyens seraient considérés comme des agents participant activement à l’exercice du pouvoir et contribuant à l’orientation des politiques. Au lieu de cela, les citoyens ressemblent davantage à des « patients » qui, selon la définition du dictionnaire, « supportent ou endurent (un mal quelconque) avec sang-froid ; souffrent longtemps ou sont indulgents. » (Wolin, 2008, 60)
Une première ligne de démarcation entre la démocratie et la non-démocratie se dessine donc sur le plan du peuple : une démocratie au sens plein du terme, même dans sa version la plus simple, implique une population informée et active.
Le totalitarisme
Qu’en est-il alors du totalitarisme ? Sans surprise, le totalitarisme inverse l’ordre démocratique :
Avant tout, il s’agit de la tentative de réaliser une conception idéologique et idéalisée d’une société comme un tout systématiquement ordonné, où les « parties » (famille, églises, éducation, vie intellectuelle et culturelle, économie, loisirs, politique, bureaucratie d’État) sont coordonnées de façon préméditée, voire par la force si nécessaire, pour soutenir et promouvoir les objectifs du régime. La formulation de ces objectifs est monopolisée par les dirigeants. (Ibid, 46)
Inversion donc de l’orientation du pouvoir : dans le totalitarisme, les gouvernants bénéficient d’une indépendance quasi parfaite de la population. Le gouvernement devient autoritaire au sens le plus radical :
Dans les régimes totalitaires classiques, on partait du principe que le pouvoir total exigeait que l’ensemble des institutions, des pratiques et des croyances de la société soient dictées d’en haut et coordonnées (gleichgeschaltet), que le pouvoir total ne pouvait être atteint que par le contrôle de tout depuis le sommet. (Ibid.)
Les dirigeants ne sont pas élus, ils se font plébisciter, tout au plus, et les gouvernés ne discutent pas de leurs décisions politiques qui pénètrent jusqu’aux moindres recoins des institutions et de la vie privée.
Les systèmes totalitaires du vingtième siècle aspiraient à un contrôle total de tous les aspects de la société et à l’élimination ou à la neutralisation de toute forme d’opposition possible. … En pratique, le contrôle s’étendait à la vie familiale et à la reproduction, à l’éducation, à l’économie, à toutes les formes d’expression culturelle, aux tribunaux, à la bureaucratie et à l’armée. (Ibid., 55)
Bien évidemment, aucun système totalitaire n’a jamais réussi à mener jusqu’à bout ce type de pouvoir, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé.
Quelle inversion ?
Si l’on pouvait dire que d’une certaine manière, le totalitarisme inverse le régime démocratique, le « totalitarisme inversé » inverse le totalitarisme et la démocratie en même temps. Quelles sont ces inversions que Wolin voit à l’oeuvre ?
La première tient au fait que le régime du totalitarisme inversé ne se présente pas comme tel. Un régime peut paraître comme non-totalitaire et même comme démocratique, s’affirmer comme tel, et pourtant porter un certain nombre de traits caractéristiques du totalitarisme.
Contrairement aux régimes totalitaires classiques qui ne perdaient aucune occasion de mettre en scène et d’insister sur une transformation radicale qui éradiquait virtuellement toutes les traces du système précédent, le totalitarisme inversé est apparu de manière imperceptible, non préméditée et dans une continuité apparemment ininterrompue avec les traditions politiques de la nation. (Ibid., 45 – 46)
L’inversion à laquelle pense Wolin est donc subreptice et masquée :
Il y a inversion lorsqu’un système, tel que la démocratie, produit un certain nombre d’actions significatives ordinairement associées à son antithèse : par exemple, lorsque le chef de l’exécutif élu peut emprisonner un accusé sans procédure régulière et sanctionner l’usage de la torture tout en instruisant la nation sur le caractère sacré de la règle de droit. Le nouveau système, le totalitarisme inversé, est un système qui prétend être le contraire de ce qu’il est en réalité. (Ibid. 46)
La prétention du contraire ne se conçoit pourtant pas comme simple mensonge, ou comme tromperie banale. Ce n’est pas un cas trivial du ‘dire une chose … et faire le contraire’. Ce que la seconde Guerre du Golfe a surtout montré, c’est qu’un président, ou un gouvernement peuvent mettre en oeuvre une guerre d’invasion, illégale sur le plan du droit international, avec un mensonge connu et reconnu comme tel. Autrement dit : un gouvernement peut oeuvrer à réaliser un crime qui coûte des centaines milliers de vies avec comme seule légitimité officielle un mensonge connu et reconnu comme tel.
Il ne suffira donc pas de reprocher au discours du pouvoir de tromper, ou de cacher son jeu, de prétendre être ou annoncer autre chose que ce qu’il fait en réalité : il ne cache ni son jeu, ni sa tromperie. Au contraire, la Guerre de l’Irak a montré qu’un pouvoir est à même de mentir, tout en sachant que ce mensonge est connu comme tel, et passera sans conséquences malgré ce fait. C’est dire que le pouvoir dont parle Wolin n’a même plus vraiment besoin de légitimité ou de justifications autres que l’instrumentalisation du danger et de la peur.
Dans « Ce que l’action révolutionnaire signifie aujourd’hui » (Wolin, 2016, p. 374 – 75) Wolin explique ce phénomène dans le contexte de la corruption politique. Les groupes dominants de l’économie politique, écrit Wolin, sont devenus tellement confiants qu’ils affirment ouvertement le pouvoir de l’argent dans le contexte de la politique. De leur point de vue, il est important que les citoyens dépolitisés ne comprennent pas seulement dans quelle mesure l’argent détermine le pouvoir, mais quelles sont les formidables sommes requises pour intervenir politiquement.
Le « totalitarisme inversé »
Le terme de « totalitarisme inversé » peut paraître trompeur, et l’on serait certainement en droit de discuter de l’usage d’un concept aussi lourdement chargé de significations et de références. Parce que quand bien même, le totalitarisme inversé ne relève tout d’abord pas du totalitarisme, à proprement parler, il n’en maintient pas moins la détermination négative. Par « totalitarisme inversé », Wolin entend désigner un système politique original, qui ne relève ni de la démocratie, ni du totalitarisme :
En inventant le terme « totalitarisme inversé », j’ai plutôt essayé de trouver un nom pour un nouveau type de système politique, apparemment dirigé par des pouvoirs totalisateurs abstraits, et non par un pouvoir personnel, qui réussit en encourageant le désengagement politique plutôt que la mobilisation de masse, qui s’appuie davantage sur les médias « privés » que sur les agences publiques pour diffuser une propagande renforçant la version officielle des événements. (Ibid., 44)
Il faudra donc distinguer le « totalitarisme inversé » du totalitarisme à proprement parler, dont en fin de compte il ne retient presque plus que le nom :
Le totalitarisme inversé fonctionne différemment. Il reflète la croyance selon laquelle le monde peut être modifié pour s’accorder avec une gamme limitée d’objectifs, tels que la garantie que ses propres besoins énergétiques seront satisfaits, que des « marchés libres » seront établis, que la suprématie militaire sera maintenue et que des « régimes amis » seront en place dans les parties du monde considérées comme vitales pour sa propre sécurité et ses besoins économiques. Le totalitarisme inversé claironne également la cause de la démocratie dans le monde. (Ibid., 52)
Contrairement au totalitarisme fasciste, nazi ou soviétique, le « totalitarisme inversé » (version autoritaire assumée du néolibéralisme) permute le rapport de pouvoir entre le politique et l’économique. Ici, ce n’est pas le pouvoir politique qui légifère « du haut vers le bas », qui cadre ou détermine le système économique, mais c’est le capitalisme monopolistique qui dirige le politique :
Le totalitarisme inversé marque un moment politique où le pouvoir des entreprises cesse finalement d’être identifié comme un phénomène purement économique, confiné principalement au domaine national de l›« entreprise privée », pour évoluer vers un copartenariat mondialisé avec l’État : une double transmutation, de l’entreprise et de l’État. (Ibid., 238)
Dans ce même contexte, la technique médiatique du marketing a été récupérée par et adaptée à la communication politique. Si bien que le discours politique, homogénéisé avec le discours médiatique, est apprêté par des experts pour servir aux intérêts particuliers des grandes entreprises politiquement actives : « la dégradation du dialogue politique promue par les médias est la base du système, et non une excroissance de celui-ci » (Ibid., 287)
Partant de ces définitions, il est difficile de ne pas penser au concept de « post-démocratie » de Colin Crouch. J’y reviendrai. Observons déjà que ce qui distingue les analyses de Wolin de celles de Crouch, c’est la place éminente qu’y occupe l’industrie de la guerre, comme industrie porteuse de l’État américain impérialiste. Ainsi, le premier moteur de l’économie et le premier moteur du pouvoir de l’État cette économie de guerre, où le privé et le public s’enchevêtrement de la manière la plus naturelle :
Cette économie est devenue de plus en plus le moyen de fabriquer le pouvoir de l’État, plutôt que des biens et des services. Ses produits, qu’il s’agisse d’armements, de haute technologie ou d’aliments issus de l’agro-industrie, sont essentiellement des comptoirs destinés à être utilisés pour obtenir des avantages sur le marché politique de l’économie internationale du pouvoir. Ainsi, l’économie nationale produit des formes de pouvoir qui, par leur nature et leur conception, ne peuvent être utilisées que par l’État – l’État dont le symbole est le Pentagone, où les représentants « publics » et « privés » mêlent leurs identités et alternent leurs emplois. (Wolin, 2016, 379)
C’est dans ce sens, que l’allusion aux formes historiques du totalitarisme peut garder tout son sens. Même si le régime semble démocratique, revendique la démocratie et n’exerce pas systématiquement la terreur contre la propre population, toutes les institutions, tous les ressorts de la politique sont « coordonnées de façon préméditée […] pour soutenir et promouvoir les objectifs du régime », si nécessaire au moyen de la neutralisation de toute forme d’opposition.
L’entente des classes
L’un des aspects les plus intéressants de l’inversion du totalitarisme envisagé par Wolin consiste dans la nouvelle fonction du peuple et dans le rapport du peuple à ses représentants politiques. Contrairement à l’idée de la représentation politique du peuple, les décideurs politiques en viennent à représenter plus directement un intérêt commun, défini sans passage par la délibération, la participation ou même la discussion publique. Ce sont les experts et les élites privées et publiques, les élus et certaines parties de la haute fonction publique qui disent le « bien commun » :
Dans sa croyance que la minorité devrait plus ou moins monopoliser le pouvoir, l’élitisme politique affiche son affinité élective avec le capitalisme. Tous deux croient que les pouvoirs d’un poste élevé, que ce soit au gouvernement ou dans les affaires, devraient être réservés à ceux qui les méritent par leurs qualités personnelles et leurs talents exceptionnels – démontrés dans des conditions hautement compétitives – plutôt qu’à ceux qui obtiennent le pouvoir en vertu de l’approbation populaire. (Wolin, 2008)
Si bien qu’on trouve les origines historiques les plus immédiates du nouvel élitisme de l’économie comportementale – soit de ce mélange d’eugénisme sublimé et de « paternalisme doux » chez Lénine, dans la théorie bolchévique de l’« avant-garde » :
Or si, au lieu du prolétariat, l’histoire a dégorgé un « amas d’humanité », ce n’est pas Marx qui est le maître de la nouvelle ère de la société de masse, mais Lénine ; ce n’est pas le prophète de la victoire prolétarienne qui parle de la condition contemporaine, mais le stratège qui perfectionne l’instrument d’action, l’élite. Si c’est l’élite, plutôt que le prolétariat, qui doit réellement ouvrir la voie, la stratégie n’est pas d’écraser le pseudo-prolétariat ou les masses, mais de les manipuler. C’est « notre devoir », écrivait Lénine, « de descendre plus bas et plus profondément, jusqu’aux vraies masses. » (Wolin, 2004, p. 377)
Il en résulte une réorganisation profonde du système juridico-politique, appuyé et renforcé par une presse complaisante et une apathie électorale correspondante :
Les éléments sont donc en place : un corps législatif faible, un système juridique à la fois souple et répressif, un système de partis dans lequel un parti, qu’il soit dans l’opposition ou dans la majorité, est déterminé à reconstituer le système existant de manière à favoriser en permanence une classe dirigeante composée de riches, de personnes bien placées et d’entreprises, tout en laissant les citoyens les plus pauvres avec un sentiment d’impuissance et de désespoir politique, et, dans le même temps, en maintenant les classes moyennes en équilibre entre la peur du chômage et l’espoir de récompenses fantastiques une fois que la nouvelle économie aura repris. (Wolin, 2003)
Ainsi, si la population, si l’assemblée des citoyens ne n’est pas dissoute dans les « masses » plébiscitaires amorphes du totalitarisme, elle n’en reste pas moins écartée de toute forme de participation, même symbolique, au pouvoir :
Les citoyens sont déplacés, coupés d’un lien direct avec les institutions législatives qui sont censées « représenter » le peuple. Si le but principal des élections est de servir des législateurs dociles que les lobbyistes peuvent façonner, un tel système mérite d’être appelé « gouvernement de mauvaise représentation ou de clientélisme ». » (Wolin, 2008, 59)
Le citoyen de la démocratie se voit réduit à la fonction de l’électeur qui, durant les périodes législatives, fournit surtout matière à des sondages d’opinions :
Presque depuis le début de la guerre froide, les citoyens, censés être la source du pouvoir et de l’autorité du gouvernement et y participer, ont été remplacés par l’« électorat », c’est-à-dire par des électeurs qui acquièrent une vie politique au moment des élections. Dans les intervalles entre les élections, l’existence politique des citoyens est reléguée à une citoyenneté fantôme de participation virtuelle. Au lieu de participer au pouvoir, le citoyen virtuel est invité à avoir des « opinions » : des réponses mesurables à des questions conçues pour les susciter. (Ibid. 55)
À l’inverse des mobilisations de masse, le totalitarisme inversé s’appuie sur une individualisation passive d’une participation désintéressée :
… le totalitarisme inversé se nourrit d’une société politiquement démobilisée, c’est-à-dire une société dans laquelle les citoyens, loin d’être fouettés par les agents du régime, sont politiquement léthargiques, ce qui rappelle la citoyenneté privatisée de Tocqueville. (Ibid, 64)
De cette manière, la lutte des classes se transforme en une collusion tacite de la sphère publique :
Ce qui est sans précédent dans cette union du pouvoir des entreprises et de l’État, c’est sa systématisation et la culture commune des partenaires. (67)
Totalitarisme inversé ou post-démocratie ?
Assurément, nul n’affirmera que le terme de « post-démocratie » est mieux choisi que celui de « totalitarisme inversé ». Pourtant, le côté dramatique en moins, l’un n’est pas sans rappeler l’autre.
En 2003, cinq ans donc avant les analyses de Wolin, le sociologue anglais Colin Crouch proposait une lecture assez similaire des changements démocratiques de l’Europe, et ce avant même que les politiques anti-terroristes n’entrent sur le devant de la scène politique en Europe.
La post-démocratie correspond à un mode de gouvernement où
les formes de la démocratie restent pleinement en place – et sont même renforcées aujourd’hui à certains égards – la politique et le gouvernement retombent de plus en plus sous le contrôle d’élites privilégiées de la manière caractéristique des temps pré-démocratiques ; et qu’une conséquence majeure de ce processus est l’impuissance croissante des causes égalitaires. (Crouch, 2004, 6)
De même, dans le diagnostic de Crouch, la démocratie passe de la représentation du peuple aux élites :
[L]‹idée que la politique est essentiellement l’affaire des élites, qui sont ensuite soumises aux reproches et à la honte d’une population de spectateurs en colère lorsque nous découvrons qu’elles ont fait une erreur. (Ibid., 14)
Et les élites que Crouch voit à l’œuvre se composent de la même entente économicopolitique que les élites de Wolin :
Une fois que le concept de ce qui fait la spécificité du service public a été ridiculisé et détruit, et que la recherche du profit personnel a été élevée au rang d’objectif humain suprême, on ne peut que s’attendre à ce que les députés, les conseillers et autres considèrent la vente de leur influence politique à des fins lucratives comme un aspect majeur et totalement légitime de leur participation à la vie politique. (Ibid., 73)
Si bien que la population, réduite à n’être qu’une cible de processus de marketing politique, tombe dans l’ennui et le désengagement politique :
L’idée de post-démocratie nous aide à décrire des situations où l’ennui, la frustration et la désillusion se sont installés après un moment démocratique ; où de puissants intérêts minoritaires sont devenus beaucoup plus actifs que la masse des gens ordinaires pour faire fonctionner le système politique pour eux ; où les élites politiques ont appris à gérer et à manipuler les demandes populaires ; où les gens doivent être persuadés de voter par des campagnes publicitaires descendantes…
Somme toute, la situation décrite par Crouch ressemble à s’y méprendre au totalitarisme inversé de Wolin. Mais Crouch situe sa genèse dans un mouvement historique un peu plus large, et sur un tout autre plan, à commencer par le tournant des politiques néolibérales de Reagan et de Thatcher. De cette manière, le « totalitarisme inversé » des politiques sécuritaires apparaît comme un cas particulier de la post-démocratie. De même, la perspective de Crouch permet d’inscrire la politique impérialiste américaine et sa « guerre contre le terrorisme » dans un mouvement d’encastrement de la politique dans les intérêts économiques privés.
Par ailleurs, Crouch est d’abord nettement plus clair que Wolin en pensant la post-démocratie comme un système politique mixte, où la démocratie n’a pas encore disparue, mais ne s’est pas moins engagée dans cette voie. En 2020, dans la reprise de son analyse – Post-Democracy After the Crises – Crouch révise cette ligne d’interprétation en constatant que la situation a évolué par-delà son pessimisme initial. Dans les 17 ans qui séparent les deux ouvrages, Crouch se rapproche de la lecture de Wolin :
La post-démocratie telle que je l’ai perçue était un processus décevant et inquiétant, mais elle n’était pas effrayante ; on pouvait y ‘faire face’. […] Bien que ces défis ne soient pas aussi extrêmes que les mouvements fascistes et nazis de l’entre-deux-guerres, ils font partie de la même famille politique. […] Si c’est là que la post-démocratie nous a amenés, ‘faire face’ est trop complaisant. La confrontation est nécessaire. (Crouch, 2020, xiv)
Pourtant, Crouch ne désespère pas d’une situation globale qui, selon ses propres dires, s’avère pire que ce qu’il avait pu anticiper. Alors que la normalisation de la « corruption » sous le chef de la politique néolibérale du « new public management » a rendu presque parfaitement perméables la frontière entre l’État et le monde des affaires – le dernier déterminant systématiquement le premier, mais jamais l’inverse (ibid., 40) – l’un des obstacles majeurs au changement serait la « nostalgie pessimiste » politisée, que Crouch voit comme l’une des marques caractéristiques des fascistes de Mussolini et des nazis de Hitler (ibid., 99) aussi bien que du populisme et de l’extrême-droite (ibid., 91 – 93) actuels.
Contre le pessimisme de l’extrême droite et du populisme de droite, Crouch propose une sorte de ‘psychologie politique positive’ :
La colère des pessimistes a une qualité différente de celle de personnes qui croient être empêchées par des adversaires d’entrer dans une nouvelle vie optimiste qu’elles n’ont jamais connue. Elle est nécessairement défensive, excluante, potentiellement destructrice de vie, et donc susceptible de s’exprimer violemment. (ibid., 97)
À côté de la colère destructrice, qui contribuerait au mouvement de décomposition de la démocratie, faudrait-il donc opter pour une colère constructrice animée par un optimisme pour l’avenir ? La lutte pour la restauration de la démocratie, reposerait-elle sur la bonne motivation et l’attitude positive des citoyens ? L’idée semble pour le moins curieuse, étant donné les analyses structurelles de la critique de la post-démocratie.
Comment s’en sortir ?
Alors que les situations que décrivent Wolin et Crouch se ressemblent au plus près, leurs interprétations des transformations de la démocratie et leurs ‘remèdes’ diffèrent radicalement : ‘faire avec’ (coping with) et confrontation discursive pour Crouch, action révolutionnaire pour Wolin.
Pour Crouch, en 2003, la post-démocratie est conçue comme tendance au sein des démocraties libérales. En 2020, elle s’apparente à un fait incontesté et même assumé. Dans un premier temps, en 2003, Crouch ne voit rien de très inquiétant dans la transformation de la démocratie qu’il décrit. En effet, si en 2003, le capitalisme paraît déjà indépassable (voir Crouch, 2004, 105), il suffirait de règlementer son emprise de manière qu’il n’empiète pas sur le processus démocratique.
Selon Crouch, un tel compromis aurait existé vers le milieu du XXᵉ siècle sous la forme de l’économie de marché sociale et de l’État providence. Et même si la ‘mise au pas’ néolibérale ne cesse d’encourager la dépolitisation de la politique et des citoyens, il y aurait moyen, s’il faut en croire le sociologue anglais, de règlementer la séparation du privé et du public à partir d’une éthique renouvelée du « service public » (voir Crouch, 2004, 105).
En 2020, Crouch pense donc que si la victoire du néolibéralisme s’est solidement installée, la possibilité de restituer un État détaché du diktat économique est toujours donnée. Si « l’esprit de Hayek » et de sa profonde méfiance pour la démocratie (Crouch, 2020, 140) l’a emporté contre la politique démocratique, les instances du salut démocratique restent à portée de main. Curieusement, selon Crouch, le secours de la démocratie tient en partie dans l’intervention d’institutions non-démocratiques – les ‘fameuses’ institutions non-majoritaires, que certains politistes comptent parmi les principaux moteurs de la régression démocratique (voir Schäfer & Zürn, 2021) – telles que la Banque Centrale Européenne et la Cour Européenne de Justice (Crouch, 2020, 148, 149). Aux yeux du sociologue, l’Europe devrait pouvoir rester optimiste face à l’emprise politique des grandes entreprises transnationales grâce à ses institutions non-démocratiques.
Par-delà les interventions de la BCE et de la CEJ, Crouch plaide également pour une réanimation de la sphère publique. Quand bien même il y a peu de raisons objectives qui permettraient de surmonter les « sentiments pessimistes nostalgiques », il faudrait compenser la réalité décourageante avec un effort de pensée positive : « Pour que la démocratie retrouve sa force, ces alternatives doivent trouver les moyens de s’exprimer de manière puissamment motivante. » (ibid., 156)
Ces alternatives tiennent dans le renforcement des politiques environnementales et dans la mise en place de politiques du genre (gender politics). Ici, les propos de Crouch commencent à ressembler aux discours des programmes électoraux – de ces mêmes partis politiques que Crouch identifie comme obstacles à la participation populaire. Soit : l’« esprit d’entreprise » (entrepreneurialism) vert, qu’il soit de gauche ou de droite (ibid., 160), éviterait le pessimisme nostalgique en affirmant les possibilités technologiques d’une économie plus « propre » et en réintroduisant une politique « fondée sur des valeurs ». Et les politiques du genre dépasseraient aussi bien le pessimisme du « masculinisme violent » traditionnel des mouvements ouvriers, que les erreurs des féminismes des années 1990, incapables d’entamer le pouvoir des entreprises. De nouveaux syndicats féminins seraient requis pour remettre à l’ordre du jour les valeurs de gauche, contre les valeurs de plus en plus conservatrices et réactionnaires des hommes sur le déclin (ibid., 164).
Mis à part un renforcement d’institutions non-majoritaires échappant à la supervision démocratique, Crouch plaide pour un effort de motivation positive et la renaissance d’une politique des valeurs, idéalement féminines. Parce que ce sont les femmes qui mieux que les hommes font l’expérience des problèmes de l’équilibre entre le travail et la vie professionnelle, de la précarité, du déclin des services de soins et de la manipulation des consommateurs (ibid., 163).
Les choses en vont tout autrement chez Wolin. Car pour Wolin, la démocratie n’est pas une affaire de bonnes institutions politiques ou de bonnes règlementations économiques. Et, encore moins une affaire de bonne volonté ou de pensée positive.
De fait, pour Wolin, sur le plan le plus fondamental, une approche du politique comme celle de Crouch ne permettrait pas de saisir son objet :
[T]ant les partisans des sciences sociales que le philosophe politique soucieux d’éthique préconisent une approche qui passe à côté du même point. La question n’est pas seulement méthodologique, ni même principalement éthique, mais substantielle, c’est-à-dire qu’elle concerne le statut de la politique et du politique. (Wolin, 2004, 288)
Qu’est-ce que le politique dès lors ? La réponse ne paraît pas simple. Le politique que Wolin associe à la démocratie n’existe que comme moment de rupture :
Je considérerai le politique comme l’expression de l’idée qu’une société libre composée de diversités peut néanmoins connaître des moments de communauté lorsque, par le biais de délibérations publiques, le pouvoir collectif est utilisé pour promouvoir ou protéger le bien-être de la collectivité. (Wolin, 2016, 1001)
Dans ce sens, le politique et la démocratie sont nécessairement fugitifs, temporaires et passagers. Au contraire, le libéralisme et la démocratie constitutionnelle représentent le dépassement du politique au sens où ils brident l’expression du collectif.
L’institutionnalisation démocratique, écrit Wolin, équivaut à l’étouffement de la démocratie. Cette dernière en vient à être remplacée par l’économie politique (que Wolin désigne encore de « despotisme postmoderne » ou de « totalitarisme inversé »), c’est-à-dire un mode de vie où la société est principalement conçue en termes de rapports économiques désencastrées de tout autre rapport social ou politique. (Wolin, 1989, 42) Dans le monde de l’économie politique, la communauté supposée par les théories contractuelles de la démocratie – « citoyen d’hier, citoyen de toujours » – n’est plus assurée. Car l’économie politique produit « une population excédentaire de personnes économiquement inutiles » :
Discipliner les pauvres devient une fonction majeure de l’économie politique, et les théoriciens sociaux répondent obligeamment en redécouvrant la nécessité d’une autorité forte. (ibid., 45)
Si bien que pour Wolin le politique se situe aux antipodes des institutions, de l’économie et même des règlementations de la justice distributive. Le moment du politique est le moment révolutionnaire :
La révolution peut être définie pour notre propos comme la transgression totale des formes héritées. Elle est l’antithèse extrême d’une constitution établie, que cette constitution soit représentée par des documents (« lois fondamentales ») ou par des systèmes ou pratiques reconnus. La démocratie est née dans des actes transgressifs, car le demos ne pouvait pas participer au pouvoir sans briser les systèmes de classes, de statuts et de valeurs qui l’excluaient. (Wolin, 2016, 106)
C’est au moment de la révolution que les exclus de l’économie politique réintègrent la sphère publique pour contribuer à une population (demos) qui actualise le politique dans un débat sur les finalités et les choix de la collectivité. En d’autres termes, le politique se conçoit nécessairement comme transgression de l’institutionnel. Le politique est le moment de la crise de la démocratie constitutionnelle où l’électeur passif reprend, pour un bref moment, le statut du citoyen actif. C’est en cela que la démocratie politique se distingue de la pseudo-démocratie de l’économie politique :
La démocratie doit être repensée comme autre chose qu’une forme de gouvernement : comme un mode d’être conditionné par une expérience amère, condamné à ne réussir que temporairement, mais qui est une possibilité récurrente tant que la mémoire du politique survit. (Wolin, 2016, 111)
Pour Wolin, donc, les nouvelles formes du pouvoir rendent incompatible la démocratie avec un système politique. C’est dans ce sens que la démocratie ne doit plus être conçue comme un type de gouvernement, mais comme une possibilité de rupture du système politique et de ses pouvoirs sur le monde social et naturel.
Malgré les analyses similaires de l’économisation autoritaire de la politique, Crouch et Wolin proposent donc des lectures on ne peut plus différentes de l’époque contemporaine. Si pour Crouch, le salut de la démocratie ne peut résider que dans une régulation extra-démocratique d’institutions trans-nationales et dans la revendication populaire d’engagements toujours déjà récupérés par la politique des partis, Wolin ne voit de sortie que par la transgression révolutionnaire de la démocratie institutionnelle. Et chez Wolin, cette transgression ne peut plus se limiter à la prise de pouvoir des classes populaires, ou de politiques identitaires. La révolution du politique doit encore mettre en jeu et réinventer « les formes et pratiques qui exprimeront la conception démocratique de la vie collective » (Ibid, 376). C’est dans ce sens que la « reconnaissance du contexte c’est la raison politique qui honore ses dettes » (Wolin, 2016, 234).
Notes
- Dans son article sur Arendt et le politique, Wolin écrit : « Historiquement, l’idée du politique et l’idée de la démocratie ont partagé tellement de significations communes qu’elles semblent presque synonymes. On ne peut pas en dire autant de la relation entre l’idée du politique et, par exemple, l’idée d’un ordre politique qui serait contrôlé par les riches ou qui répondrait principalement à leurs besoins. » (Wolin 2016, 246 – 247) ↩︎
Bibliographie
- Brown, Wendy. 2007. « Democracy and Bad Dreams ». Theory & Event 10(1).
- Crouch, Colin. 2000. « Coping with Post-Democracy ». Fabian Society.
- Crouch, Colin. 2004. Post-democracy. Malden, MA : Polity Press.
- Crouch, Colin. 2020. Post-Democracy After the Crises. Medford, MA : Polity Press.
- Hennette Vauchez, Stéphanie. 2022. La Démocratie en état d’urgence : Quand l’exception devient permanente. Paris : Editions du Seuil.
- Hennette Vauchez, Stéphanie, Maria Kalogirou, Nicolas Klausser, Cédric Roulhac, Serge Slama, et Vincent Souty. 2018. « Ce que le contentieux administratif révèle de l’état d’urgence ». Cultures & conflits (112):35‑74.
- Jones, Adrian L., et Rhoda E. Howard-Hassmann. 2005. « Under Strain : Human Rights and International Law in the Post 9/11 Era ». Journal of Human Rights 4(1):61‑71.
- Sidel, Mark. 2006. « Après le Patriot Act : la seconde vague de l’anti-terrorisme aux États-Unis ». Critique internationale 32(3):23‑37.
- Manin, Bernard. 2012. Principes du gouvernement représentatif. Paris : Flammarion.
- Schäfer, Armin, et Michael Zürn. 2021. Die demokratische Regression. Berlin : Suhrkamp Verlag AG.
- Wolin, Sheldon. 2008. Democracy Incorporated. Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism. Princeton (N.J.): Princeton University Press.
- Wolin, Sheldon. 1996. « Democracy & Counterrevolution ». Nation 262(16):22‑24.
- Wolin, Sheldon. 2016. Fugitive Democracy : and Other Essays. Édité par N. Xenos. New Jersey : Princeton University Press.
- Wolin, S. (2003, mai 1). « Inverted Totalitarianism ». https://www.thenation.com/article/archive/inverted-totalitarianism/
- Wolin, Sheldon. 2004. Politics and Vision : Continuity and innovation in Western Political Thought. Expanded ed. Princeton, N.J : Princeton University Press.
- Wolin, Sheldon. 1989. The Presence of the Past : Essays on the State and the Constitution. Baltimore : Johns Hopkins University Press.