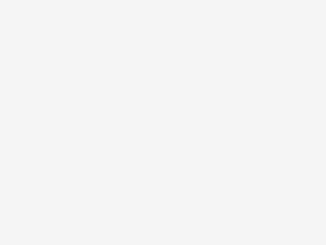Renaud Girard, & Jean-Loup Bonnamy. (2020). Quand la psychose fait dérailler le monde. Paris : Gallimard.
Fin 2022, en pleine pandémie, Renaud Girard (journaliste et grand reporter au Figaro) et Jean-Loup Bonnamy (philosophe et essayiste) publient un essai polémique qui interroge les fondements politiques, médiatiques et scientifiques de la gestion de la crise du Covid-19. Loin de s’attarder sur les aspects virologiques ou médicaux du virus, les auteurs examinent les réactions politiques et médiatiques à la pandémie qu’ils jugent excessives, irrationnelles et potentiellement destructrices :
Dans son roman L’Étranger, Albert Camus écrivait que l’homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère se rend suspect à toute la collectivité. Dans notre nouvelle société, égoïste et obsédée par son « principe » de pré-caution, l’inversion des valeurs est telle que le suspect est désormais celui qui accomplit les plus anciens rites humains : assister les mourants ; veiller, puis enterrer les morts. Le sort de l’Antigone de Sophocle, condamnée pour avoir enterré son frère, ne nous paraît plus si étranger. Girard & Bonnamy, p. 37)
Dès les premières pages, l’ouvrage adopte un ton critique à l’égard des politiques de confinement, de la généralisation du port du masque, des mesures de distanciation et des fermetures administratives. Pour Bonnamy et Girard, ce n’est pas tant le virus lui-même qui a bouleversé le monde que la « psychose » qu’il a engendrée. Au croisement de la peur médiatique, de la surréaction politique et de l’aveuglement des institutions, le confinement de masse s’est imposé comme un réflexe archaïque, plus proche du geste magique que d’une décision rationnelle.
Le livre reproche aux décideurs de s’être appuyés sur des modèles épidémiologiques erronés (comme ceux de l’Imperial College), sur des métaphores guerrières, et surtout une mise en scène permanente de la terreur, ayant comme effet de légitimer, sans autre argument, les libertés publiques, les droits et libertés fondamentales des démocraties occidentales.
Contrairement aux évaluations subjectives qui persistent à euphémiser le « peu de restrictions », l’analyse croisée des mesures sanitaires adoptées dans l’Union européenne lors de la pandémie de Covid-19 et des articles de la Charte des droits fondamentaux permet de constater une atteinte systémique à un nombre considérable de droits. Ainsi, de 18 à 20 droits sur les 50 garantis par la Charte européenne ont été limités ou temporairement suspendus. Et, ces atteintes ne se sont pas restreintes à des domaines périphériques ou techniques mais ont touché au cœur normatif du projet démocratique européen. Ne rappelons, à titre d’exemple, que la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté de religion, la liberté d’entreprendre, le droit à la vie privée, droit à l’éducation, droit au travail… (voir Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 2021, Commission de Venise, 2020 ; Conseil de l’Europe, 2020 ; Parlement européen, 15 septembre 2022 et surtout aussi Hennete Vauchez, 2022).
Par-delà cette atteinte historique des principes normatifs de l’ordre démocratique libéral, c’est encore la structure même de la rationalité politique moderne qui s’est trouvée bousculée. Comme le montrent les auteurs, le pouvoir a été exercé non pas tant pour restreindre de manière ciblée certaines libertés dans un cadre juridiquement exceptionnel et clairement délimité, que pour réorganiser, sur la durée, l’ensemble des interactions sociales à partir d’un paradigme de gestion du risque biologique. Une logique qui est parfaitement lisible à travers les outils conceptuels de la biopolitique, tels que les a pensés Michel Foucault. Ici, tout repose sur des « dispositifs de normalisation » (Foucault, 2004), de traçabilité, de contrôle des corps et de circulation différentielle selon des critères de conformité sanitaire.
Au-delà de la critique conjoncturelle, l’intérêt de l’ouvrage réside dans la tentative d’y voir un symptôme d’une mutation plus profonde : la montée d’un gouvernement des corps par la peur. Et c’est dans ce contexte que le rapprochement avec Michel Foucault devient particulièrement pertinent.
La notion de biopolitique, formulée par Foucault à partir de ses cours au Collège de France dans les années 1970 (notamment dans Il faut défendre la société 1997, et Naissance de la biopolitique), désigne une forme de pouvoir qui prend pour objet la vie elle-même, non plus seulement pour punir ou contraindre, mais pour organiser, surveiller, optimiser, réguler. Cette forme de pouvoir ne s’exerce pas tant par la loi ou la répression que par des dispositifs.
Or, la pandémie de Covid-19 a été le théâtre d’une mise en œuvre spectaculaire de ce que Foucault appelait un dispositif de « disciplinarisation » : un ensemble hétérogène de mesures, d’outils techniques, de normes comportementales, de discours et de routines qui agissent conjointement sur les corps et les esprits.
Les gestes barrières, la distanciation physique, le port obligatoire du masque, les QR codes sanitaires, le traçage numérique, l’interdiction de déplacement, le contrôle d’accès à la vie publique selon des critères biomédicaux : autant d’éléments qui forment un régime biopolitique d’exception, où le pouvoir se justifie par la nécessité de protéger la vie, mais en prenant appui sur des logiques de contrôle et de normalisation.
Dans cette perspective, le masque n’est pas seulement un outil sanitaire. Il devient une technologie de visibilité inversée : il rend le visage opaque tout en rendant le corps social lisible en tant qu’objet de conformité. Il devient l’élément-signature d’une société du contrôle, à la fois symbole de vertu civique, indicateur d’obéissance et dispositif de différenciation entre le bon citoyen et le déviant.
De même, la distanciation sociale, que les auteurs jugent contraire à la logique même de la vie collective, peut être lue comme un exemple de cette disciplinarisation par dispersion : elle disloque les regroupements, atomise les liens sociaux et produit des individus isolés, désolidarisés, faciles à administrer.
Le pass sanitaire (et plus encore son extension vaccinale) incarne sans doute le cœur du dispositif biopolitique contemporain. Il opère une sélection algorithmique de l’accès à la vie publique, établit une hiérarchisation des corps selon leur conformité aux normes médicales, et délègue aux restaurateurs, aux agents de sécurité ou aux guichetiers un pouvoir de contrôle biopolitique.
Foucault avait montré dans Surveiller et punir (1993) comment les sociétés modernes substituent aux grands appareils punitifs un maillage capillaire de micro-pouvoirs, distribués dans l’espace social. Le pass sanitaire, comme technologie de vérification décentralisée, illustre ce passage d’un pouvoir vertical à un pouvoir diffus.
Bonnamy et Girard parlent de « psychose » pour qualifier la réaction sociale face au virus. Ce terme psychiatrique n’est pas anodin ; il désigne une rupture avec le réel, une perte de contact avec la proportionnalité. Le livre accuse les gouvernements d’avoir cédé à une logique de gestion par la peur, et d’avoir remplacé la rationalité politique par une forme d’hystérie collective.
Mais là où leur analyse reste partiellement extérieure, la grille foucaldienne permet de voir que cette prétendue irrationalité est en réalité une logique du pouvoir parfaitement cohérente. Elle met en lumière un gouvernement des vivants fondé sur la gestion différentielle des risques, la prédiction algorithmique, et la médicalisation des rapports sociaux.
En définitive, Quand la psychose fait dérailler le monde peut être lu comme un document de terrain pour une généalogie foucaldienne de la crise sanitaire. En dénonçant les excès du confinement et de la discipline sociale, les auteurs pointent du doigt les modalités concrètes par lesquelles le pouvoir contemporain s’exerce — non plus en réprimant, mais en encadrant les comportements, en produisant des normes, et en organisant l’espace social selon des critères sanitaires.
Bibliographie :
- Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. (2021). « Rapport 2021 sur les droits fondamentaux. » Luxembourg : Publications Office of the European Union. https://fra.europa.eu/en/publication/2021/fundamental-rights-report-2021
- Commission de Venise. (2020). « Respect for democracy, human rights and the rule of law during states of emergency – reflections. » Conseil de l’Europe. Opinion n° 995/2020. https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-PI(2020)005‑e
- Conseil de l’Europe. (2020, 7 décembre). « The impact of Covid-19 on human rights and how to move forward. » Déclaration de Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme. https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-impact-of-covid-19-on-human-rights-and-how-to-move-forward
- Foucault, M. (1993). Surveiller et punir : Naissance de la prison. Paris : Gallimard.
- Foucault, M. (1997). « Il faut défendre la société. » Cours au Collège de France, 1975 – 1976. Paris : Gallimard.
- Foucault, M. (2004). Naissance de la biopolitique : Cours au Collège de France, 1978 – 1979. Paris : Gallimard.
- Foucault, M. (2004). Sécurité, Territoire, Population. Paris : Seuil.
- Hennette Vauchez, S. (2022). La Démocratie en état d’urgence : Quand l’exception devient permanente. Paris : Editions du Seuil.
- Parlement européen. (2022, 15 septembre). Résolution du Parlement européen sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2020 et 2021 (2021/2186(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA‑9 – 2022-0325_FR.html