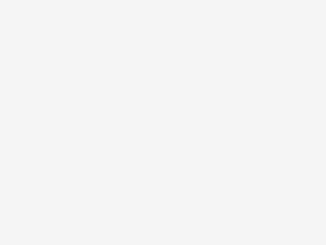Stéphane Velut. (2020). L’Hôpital, une nouvelle industrie : Le langage comme symptôme. Paris : Gallimard.
Dans L’hôpital, une nouvelle industrie, Stéphane Velut, neurochirurgien hospitalier, livre un pamphlet bref, mais dense et incisif, d’une justesse souvent époustouflante contre la mutation de l’hôpital public en une entreprise gestionnaire, soumise aux logiques du rendement, du contrôle, et surtout, de la rentabilité.
Velut dissèque deux aspects fondamentaux de cette transformation. D’une part, le langage managérial euphémisant, la novlangue anesthésiante qui recouvre la brutalité de la réorganisation néolibérale d’un vernis de modernité bienveillante. D’autre part, la marchandisation systémique de la maladie et la réduction du malade à un vecteur de flux financier.
L’un des apports majeurs du livre réside dans son examen ›chirurgical‹ de la transformation du langage hospitalier. Ce glissement lexical, à première vue anodin, constitue en réalité une opération idéologique massive. Velut y voit une véritable grammaire du pouvoir technocratique, dont la fonction première n’est pas d’éclairer, mais de recouvrir les objectifs économiques d’un discours de performance, de recouvrir la souffrance des soignants par des indicateurs de satisfaction et de recouvrir l’urgence médicale par une temporalité budgétaire.
Ainsi, le malade est devenu un usager du système de soins, parfois même un client. L’ironie étant qu’il paie sans jamais pouvoir choisir. Les soins constituent des prestations, soumises à des flux de production et le médecin devient, horribile dictu, un opérateur de santé, intégré à la chaîne logistique du parcours de soins. Cette transformation sémantique n’est pas neutre. Elle déplace très concrètement le soin de l’éthique vers l’efficacité, de la relation vers la ressource, de l’engagement vers la procédure.
Ce langage, explique Velut, adouci, neutre, dépolitisé, ne vise pas à décrire le réel, mais à le formater, à le construire en accord avec les intérêts managériaux et commerciaux des consultants. Le langage managérial agit dès lors comme un sédatif cognitif, destiné à neutraliser toute critique. Car comment s’opposer à la dynamique de rationalisation, à l’optimisation du circuit patient, à la sacrosainte « gestion efficiente des ressources humaines » ? À travers cette novlangue, c’est la violence managériale elle-même qui devient invisible, absorbée dans une rhétorique de progrès et de professionnalisation.
Dans ce contexte, Velut ne manque pas d’ironie. Il évoque ces réunions de service où les chefs de pôles, armés de graphiques et de KPI (Key Performance Indicators), expliquent aux médecins comment ils doivent augmenter leur activité, et ce non pas pour soigner davantage, mais pour remplir les objectifs de codification permettant le financement du service. Tout acte médical doit être traçable, valorisable, régulé, soit : rentable. Du soin, on ne retient que ce qui génère du revenu ou du retour sur investissement :
Ainsi le portrait contemporain du système hospitalier brossé, on le voit clairement prendre le visage d’une industrie. Il en reproduit parfaitement les modèles qui l’organisent : gestion des stocks et des flux, circuits standardisés, organisation managériale, inflation des graphes, architecture de type casiers ou rayonnages « à granulométrie faible » encourageant à la vitesse. L’individu y est devenu un objet potentiel de rentabilité, comme il est dans un « système de transaction généralisée […] une valeur d’échange » [Houellebecq]. (p. 35)
Le second grand axe du livre, qui prolonge naturellement le premier, est la conversion de l’hôpital en une industrie de traitement des flux pathologiques, où la maladie devient une ressource exploitable, et le malade, un vecteur de revenu. Le soin, autrefois inscrit dans une logique de besoin, devient une variable économique, soumise à des arbitrages comptables.
Ce basculement est rendu possible par la mise en place de la « tarification à l’activité », la fameuse T2A. Cellci-ci repose sur un système de codification des actes médicaux où chaque geste, chaque opération, chaque séjour hospitalier est codé, indexé, monétisé. Le soignant est ainsi invité à penser non plus en termes de nécessité clinique, mais en termes de, acronyme oblige, GHS (« groupes homogènes de séjours »), c’est-à-dire des unités de mesure tarifaire qui déterminent le montant remboursé à l’hôpital.
Le paradoxe résultant est cruel : dans ce modèle, un malade n’existe économiquement qu’à travers ce qu’il rapporte, et plus il est atteint de pathologies complexes, mieux il peut, potentiellement, « valoriser » le service. Cela aboutit à des situations absurdes, dans lesquelles un médecin est implicitement incité à préférer les pathologies rentables aux soins chroniques peu valorisés, à raccourcir les séjours hospitaliers pour optimiser les rotations de lits, ou à programmer des actes techniques plutôt que des consultations.
Velut dénonce une logique inhumaine, profondément contraire à l’éthique du soin, où la rentabilité prime sur la vulnérabilité, et où la finalité du soin se dilue dans l’objectif de performance budgétaire. Le personnel soignant, lui aussi, est pris dans cette logique : il devient un « coût » à maîtriser, soumis à des restructurations, des mutualisations de services, des restrictions de poste. L’hôpital public est ainsi géré comme une entreprise déficitaire, à redresser en rationalisant son fonctionnement — quitte à sacrifier le temps, la qualité, l’attention et l’écoute :
Il se passe à l’hôpital ce qu’il se passe dans les autres secteurs. L’expansion technique, numérique, robotique recrute de nos jours un nombre considérable de disciples qui y portent un regard de nature pratiquement mystique. […] Une dévotion universelle est le moyen le plus efficace de mener les hommes. Que la vie quotidienne de l’Occidental en soit radicalement transformée au bénéfice d’une standardisation de l’individu (comme des objets et des paysages d’ailleurs) est un autre sujet. Le problème est qu’à l’instar de toutes les religions, celle-ci sécrète des intégristes. Beaucoup d’entre eux admettent mal que la technique pourra remplacer bon nombre de métiers sauf ceux impliquant la main, prolongement créatif et affectif du cerveau. Ils croient dur comme fer à l’obsolescence de cet organe – voire la programment. (p. 37)
Velut parle de l’hôpital comme d’une usine où l’on fabrique du soin comme on assemblerait des pièces , d’un monde où les médecins sont invités à penser comme des ingénieurs de production et où les patients sont traités à flux tendu. À la froideur des indicateurs, Velut oppose la lenteur nécessaire du diagnostic et du traitement, la densité de la parole humaine et l’éthique du soin médical.
Ce que Velut propose, c’est une contre-épistémologie du soin, un effort pour désengluer la médecine de l’emprise du langage économique. Son court essai est une mise en garde mais aussi une interpellation : comment une société peut-elle encore soigner, si elle ne pense plus le soin autrement que comme un centre de coût ?
Pourtant l’ouvrage de Velut ne se contente pas de déplorer. Il appelle aussi repolitiser le soin, à résister au langage du management et à repenser la médecine comme relation humaine fondée sur la gratuité de l’attention et l’irréductibilité du singulier. Il y voit une nécessité démocratique : car un système de santé qui oublie que la souffrance ne se chiffre pas, que la douleur ne se réduit pas à une courbe, est un système qui s’éloigne de sa raison d’être.
L’ouvrage de Stéphane Velut se lit comme un cri d’alerte à la fois clinique, politique et philosophique contre la transformation insidieuse du système de santé en un appareil de production rationalisé, où l’humain est réduit à l’état de ressource.
Voir également :
- Velut, S. (2004). L’illusoire perfection du soin : Essai sur un système. Paris : Éditions L’Harmattan.
- Velut, S. (2021). La Mort hors la loi. Paris : Gallimard.